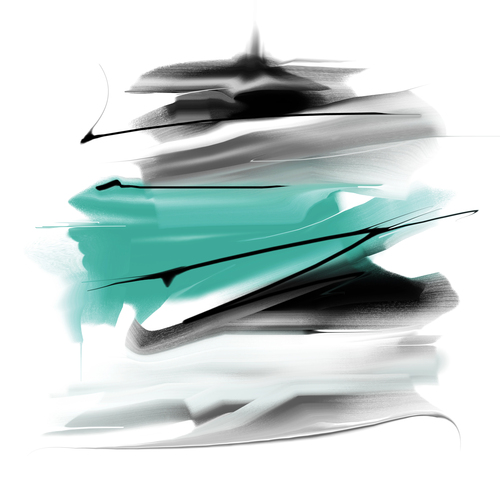Cass. com., 9 juillet 2025, n°24-10.428 et n°23-21.160 La Cour de cassation a clarifié avec pédagogie dans deux arrêts les limites et articulations entre dispositions statutaires et engagements extra-statutaires en matière de révocation des dirigeants dans les SAS. Dans les SAS, les statuts ne se contournent pas – mais les associés peuvent prendre des engagements additionnels hors statuts et hors décision d’assemblée générale. 1. Révocation ad nutum : quand les statuts l’emportent sur tout le reste Dans l’affaire n°24-10.428, M. L.-V. avait été nommé directeur général de la société Ile-de-France démolition par une assemblée générale mixte du 2 octobre 2019. Cette assemblée avait adopté, à l’unanimité, une annexe précisant les conditions particulières et restrictives de révocation du directeur général, divergeant explicitement des statuts initiaux prévoyant une révocation « ad nutum » ( ou révocation sans motif). Le 26 juin 2020, la société Newco Green Holding, agissant en qualité de présidente de la société Ile-de-France démolition, avait révoqué M. L.-V. sans invoquer de motif précis. Ce dernier a contesté sa révocation devant les tribunaux, réclamant des indemnités pour révocation sans juste motif en se fondant sur l’annexe adoptée par l’assemblée générale. La Cour d’appel de Paris lui a donné d’abord raison, considérant que l’annexe, bien qu’extra-statutaire, avait valeur contraignante en raison de son adoption unanime. La Cour de cassation a cassé cette analyse, rappelant avec clarté la primauté absolue des dispositions statutaires : « Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » Elle ajoute ensuite : « En statuant ainsi, alors que la décision collective des associés organisant différemment les conditions de révocation, même prise à l’unanimité, ne pouvait valablement contredire l’article 23.2 des statuts prévoyant expressément la révocation ad nutum du directeur général, la cour d’appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce. » Seuls les statuts définissent les conditions de révocation. Toute dérogation suppose une modification formelle des statuts. La haute juridiction réaffirme ainsi une règle fondamentale : les règles statutaires ont force obligatoire et exclusive dans l’organisation de la gouvernance de la SAS. Les résolutions, annexes ou décisions collectives n’ont aucune portée juridique si elles contreviennent aux statuts. Accepter l’inverse reviendrait à permettre une instabilité du cadre statutaire au gré d’assemblées dérogeant aux statuts et une moins bonne lisibilité des règles applicables à la vie de l’entreprise. 2. L’engagement personnel : la voie parallèle de la souplesse contractuelle À l’inverse, l’arrêt n°23-21.160 démontre que l’engagement personnel extra-statutaire reste une voie pleinement ouverte pour moduler la relation entre les associés ou avec le dirigeant, sans remettre en cause les statuts de la SAS. Dans cette affaire, M. O. avait été nommé directeur général de la société Sogecler par l’associé unique, avec la garantie d’une indemnité forfaitaire prévue dans une résolution en cas de révocation anticipée. Parallèlement, dans un protocole d’investissement signé le même jour, les associés majoritaires (MM. B., L. et la société Troizef) s’étaient personnellement engagés à assurer cette nomination et à faire prévoir une telle indemnité dans la décision de nomination. Révoqué avant l’expiration du délai convenu, M. O. avait réclamé à la société Sogecler et aux associés majoritaires le versement de l’indemnité prévue. La Cour d’appel de Nancy a rejeté la demande au motif que cet engagement était incompatible avec les statuts, qui prévoyaient une révocation sans indemnité. Là encore, la Cour de cassation casse la décision d’appel. L’engagement personnel pris par des associés ou des tiers n’est pas soumis aux règles statutaires, car il n’engage pas la société elle-même. Pour la Cour de cassation « cette disposition extra-statutaire ne renferme qu’un engagement personnel des signataires du protocole d’investissement de faire le nécessaire pour que la décision de nomination de M. [O] en qualité de directeur général de la Sogecler prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans, de sorte qu’elle n’est pas contraire à l’article 16 des statuts de la Sogecler ». Cet arrêt distingue donc clairement le régime interne de la SAS (réglementé par les statuts) et le régime contractuel privé entre personnes liées à la SAS. Il renforce la portée des engagements extra-statutaires en affirmant leur efficacité, dès lors qu’ils n’empiètent pas sur les prérogatives de la société ou sur les modalités statutaires de direction. 3. Deux décisions, une règle claire Ces deux arrêts, rendus le même jour, s’éclairent l’un l’autre et construisent une grille de lecture utile pour la pratique. Les statuts forment un socle garant de la sécurité juridique et de la transparence pour les tiers, tandis que les engagements extra-statutaires permettent une personnalisation contractuelle entre associés ou investisseurs, dans des espaces privés et volontaires. Des engagements dérogatoires aux statuts ne peuvent être pris par une décision d’assemblée générale mais ils peuvent être pris par un ou plusieurs associés dans une convention ou un contrat séparé. La lecture conjointe de ces deux décisions permet en effet de conclure que les actes extra-statutaires peuvent prendre des engagements distincts des règles statutaires mais une décision d’assemblée générale ne peut valoir dérogation exceptionnelle aux statuts même si celle-ci a été prise à l’unanimité. Cette solution doit être approuvée car admettre une dérogation aux règles statutaires par une décision collective des associés créerait une incertitude juridique notamment pour les actionnaires nouveaux ou les tiers et un défaut de lisibilité des règles sociales. Les règles statutaires prévalent. Si les associés sont tous d’accord pour changer les règles, ils doivent donc les modifier mais ils ne peuvent en aucun cas y déroger par une décision d’assemblée générale. En revanche, si un associé souhaite prendre personnellement un engagement complémentaire aux statuts alors il a la possibilité de le faire mais par un contrat séparé. Conclusion Cette solution impacte les praticiens
Siège social des sociétés : l’importance de la présomption légale de l’adresse déclarée au registre du commerce et des sociétés
Cass. civ. 2ème, 12 juin 2025, n°22-24.111 La Cour de cassation précise les modalités d’application de la présomption légale relative au siège social des sociétés, en soulignant que celui-ci reste réputé être celui inscrit au registre du commerce tant qu’aucun changement n’est opéré légalement, sauf preuve explicite de fraude ou fictivité. La société SCI BD avait formé une déclaration de saisine devant la cour d’appel de Paris, en indiquant une adresse de siège social contestée par la société Etude JP et la société Pool, sur la base d’une impossibilité pour un huissier de signifier des actes à cette adresse. La cour d’appel avait prononcé la nullité de la déclaration de saisine en considérant erronée l’adresse indiquée par la SCI BD. La Cour de cassation censure cette décision et rappelle la règle essentielle selon laquelle : « Une société, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux. » Elle précise ainsi qu’en l’absence de preuve explicite démontrant que le siège social est fictif ou frauduleux, la simple difficulté pratique rencontrée lors d’une signification ne suffit pas à remettre en cause la validité juridique du siège social régulièrement inscrit. Cet arrêt confirme donc l’importance de l’inscription officielle du siège social. La mention du siège social dans un acte est valable sauf si ce siège est fictif ou frauduleux. Ce n’est pas parce que l’huissier Cette solution est la bienvenue pour les praticiens. Il arrive souvent qu’un huissier ait du mal à délivrer un acte alors même que la société est bien domiciliée à cette adresse notamment lorsqu’aucune boite aux lettres n’existe au nom de la société. La solution inverse aurait conduit à de multiples discussions lorsque l’huissier rencontre des difficultés à signifier un acte. Cette solution de la Cour de cassation présente donc l’avantage de limiter les débats autour de l’adresse de la société et de renforcer le siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés. Par Olivier VIBERT KBESTAN, cabinet de droit des affaires à Evreux et Paris. www.kbestan.fr
Fixation judiciaire du prix de cession d’un fonds de commerce : un rappel clair des limites du pouvoir du juge
Cass. com., 4 juin 2025, n°24-11.580 Dans cet arrêt, la Cour de cassation souligne clairement que le juge ne peut substituer son appréciation à celle des parties pour fixer le prix d’une vente. Cette décision réaffirme l’interdiction formelle pour le juge de procéder à une fixation judiciaire du prix et délimite les pouvoirs des juges. La société Pharmacie Girardeaux avait conclu une promesse de cession d’un fonds de commerce de pharmacie à la société Pharmacie Bourdois, prévoyant une détermination du prix définitif par référence à un chiffre d’affaires annuel retraité de divers éléments. Faute d’accord définitif entre les parties sur les éléments à déduire, un tiers évaluateur devait être désigné pour fixer définitivement le prix. La cour d’appel de Poitiers avait néanmoins décidé elle-même de fixer le prix de cession, en estimant le montant des éléments contestés et en procédant ainsi à une évaluation judiciaire directe. La Cour de cassation censure vigoureusement cette décision en rappelant le principe posé par les articles 1591 et 1592 du Code civil selon lequel « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » ou à défaut, être fixé « par un tiers » mais en aucun cas par le juge : « En approuvant le tribunal d’avoir chiffré lui-même, pour déterminer le prix de cession, le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient en désaccord, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Cette décision rappelle clairement que les juges ne peuvent intervenir que dans les limites strictes définies par les parties et par la loi, et ne peuvent en aucun cas substituer leur propre appréciation à celle d’un tiers évaluateur désigné ou à désigner selon le processus qui avait été défini dans le contrat. Cette décision conforte ainsi la sécurité juridique des contrats et la volonté des parties, le juge ne pouvant pas prendre l’initiative de se substituer à ce tiers. L’intention était certainement louable mais le juge doit se limiter à ce que les parties ont défini. Par Olivier Vibert, Avocat au barreau de Paris et associé au sein du cabinet de droit des affaires KBESTAN.
Devoir d’information précontractuelle dans une cession de parts sociales : le champ de l’information précontractuelle se limite à une information déterminante
Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 mai 2025, n° 23-17.948 Par un arrêt rendu le 14 mai 2025 (n° 23-17.948), la Chambre commerciale précise avec rigueur les limites du devoir d’information précontractuelle imposé par l’article 1112-1 du code civil en précisant que l’information doit avoir été déterminante pour entrer dans le giron de cette obligation d’information précontractuelle. La Cour de cassation vient donc ainsi restreindre le champ de cette obligation. Faits et procédure En l’espèce, M. T. avait acquis auprès de M. M. l’intégralité des parts sociales d’une société exerçant une activité de restauration rapide. Peu après cette acquisition, M. T. constata l’impossibilité matérielle d’exercer pleinement son activité dans le local commercial loué, principalement en raison de l’interdiction d’installer un système efficace d’extraction des fumées, notamment indispensable pour la friture. Cette interdiction était due aux règles spécifiques du règlement de copropriété et à l’opposition des autres copropriétaires. Estimant que ces contraintes représentaient une information cruciale, nécessairement connue du cédant mais non révélée lors des négociations précontractuelles, M. T. assigna M. M. en indemnisation sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, considérant cette omission comme une violation du devoir précontractuel d’information. La cour d’appel de Reims rejeta toutefois les prétentions de M. T., estimant que ce dernier n’avait pas démontré que la possibilité de faire de la friture constituait une condition déterminante de son consentement lors de l’acquisition. Solution de la Cour de cassation La Cour de cassation confirme fermement la position des juges d’appel, rappelant que le devoir d’information précontractuelle prévu par l’article 1112-1 du code civil se limite strictement aux informations ayant « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » et dont « l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ». La Cour souligne particulièrement que « les moyens, pris en leur première branche, qui postulent que le devoir d’information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, ne sont donc pas fondés ». Autrement dit, il ne suffit pas que l’information omise soit simplement pertinente ou utile ; elle doit être absolument déterminante du consentement. De plus, la Cour valide expressément l’appréciation des juges du fond selon laquelle il n’était pas démontré de façon probante que « la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de M. T. ». Les juges confirment ainsi que c’est bien au demandeur de démontrer le caractère déterminant de l’information omise. Portée de l’arrêt Cet arrêt constitue une clarification notable du devoir d’information précontractuelle et une limitation de son champ d’application. Il impose aux parties une attention particulière quant à l’établissement précis du caractère déterminant d’une information lors des négociations précontractuelles. Cette rigueur protège les contrats commerciaux d’une incertitude excessive sur la portée des obligations précontractuelles et rappelle aux contractants l’importance de clairement documenter leurs attentes déterminantes lors de la formation d’un contrat. Cette décision aura donc des applications très concrètes et nécessitera d’être plus vigilant sur la nature déterminante d’éléments du contrat. Par Olivier VIBERT, Avocat au Barreau de Paris,
Expertise en évaluation de parts sociales : l’expert détient seul le pouvoir de fixer la valeur des parts sociales
Cour de cassation, Chambre Commerciale arrêt du 7 mai 2025, pourvoi n°23-24.041 Dans cet arrêt du 7 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les limites du contrôle que peut exercer un juge sur la mission d’un expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil pour l’évaluation des parts sociales. Plusieurs sociétés actionnaires avaient été exclues de la société Pharmabest. Un expert avait été désigné judiciairement afin de déterminer la valeur des actions détenues par les sociétés exclues, en application des statuts ou conventions existantes. L’article 1843-4 du code civil dispose que : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. » L’évaluation de la valeur des parts sociales est souvent un sujet délicat et source de litiges, les critères d’évaluation retenus par un expert étant rarement acceptés par tous les associés. Dans cette affaire, face au désaccord des parties sur l’exercice comptable à prendre en compte pour fixer cette valeur, l’expert avait proposé deux évaluations différentes. L’expert a laissé ensuite au juge le soin de sélectionner l’évaluation à retenir selon l’interprétation de la volonté des associés. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a cependant annulé certaines clauses de la lettre de mission, estimant que l’expert ne pouvait proposer plusieurs évaluations et devait suspendre sa mission en invitant les parties à saisir le juge afin que celui-ci tranche préalablement le litige sur l’interprétation des conventions. La Cour de cassation casse partiellement cette décision, rappelant fermement que l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil détient seul le pouvoir de fixer la valeur des parts sociales. L’expert peut valablement retenir plusieurs évaluations correspondant aux interprétations différentes revendiquées par les parties, laissant alors au juge le soin d’identifier la commune intention des parties pour choisir l’évaluation appropriée. En obligeant l’expert à interrompre ses travaux et à solliciter une intervention judiciaire préalable sur l’interprétation contractuelle, la Cour d’appel avait excédé ses pouvoirs et violé l’article 1843-4, I, du Code civil. La Cour de cassation réaffirme ainsi clairement l’autonomie et l’étendue des pouvoirs de l’expert en matière d’évaluation des parts sociales. Elle valide ainsi la démarche de l’expert qui en présence de deux interprétations possibles avait préféré ne pas arbitrer entre ces interprétations et laisser au juge le soin de faire cet arbitrage. Cette volonté de l’expert était louable et respectueuse de la limite de ses pouvoirs, laissant au juge ensuite la liberté de choisir le mode d’évaluation à retenir. Cette solution était surtout plus efficace, permettant à l’expert de clore sa mission puis de laisser les juges arbitrer. La solution de la Cour d’appel d’Aix était plus complexe et contraignante. Elle imposait les parties à une double procédure. Cette solution de la Cour de cassation semble donc pragmatique et limite le risque d’une complexité procédurale inutile. Par Olivier Vibert, Avocat au Barreau de Paris
Le créancier n’a pas qualité pour demander la désignation d’un administrateur provisoire de son débiteur
Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-20.471 Pour la Cour de cassation, le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire de celle-ci. 1. Les faits Deux sociétés étrangères, The Family Fellowship LLP et The Family Global Godfathers SPC, se prétendaient créancières de la société française Thelema. Elles alléguaient que cette dernière était instrumentalisée par son dirigeant, M. [U], pour dissimuler des agissements frauduleux. En invoquant des risques de fonctionnement anormal et de détournement d’actifs, elles ont sollicité la désignation d’un administrateur provisoire. 2. La procédure La cour d’appel de Caen, par un arrêt du 29 juin 2023, a rétracté une ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire. Elle a estimé qu’aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent ne justifiait cette mesure. Les deux sociétés ont formé un pourvoi en cassation. 3. La question juridique Un créancier d’une société peut-il demander la désignation d’un administrateur provisoire de cette société ? 4. La solution de la Cour de cassation Par cette décision du 7 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative. Le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire de celle-ci. Constatant que les demanderesses fondaient leur action sur leur seule qualité de créancières, la Cour déclare leur demande irrecevable. En effet, il est jugé que : « Le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire de celle-ci. L’arrêt constate que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers se prévalent de leur qualité de créancières de la société Thelema au soutien de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de cette société. Il s’ensuit que leur action n’est pas recevable. » 5. Portée de l’arrêt Cet arrêt rappelle que l’administration d’une société relève de sa propre gouvernance, sous le contrôle des associés et, en cas de dérives, des juridictions saisies par ceux ayant qualité. En l’absence de texte spécial, un créancier ne peut s’immiscer dans la gestion interne d’une société en sollicitant la nomination d’un administrateur provisoire. Cette décision vient donc limiter les pouvoirs des créanciers qui ne doivent pas s’immiscer dans la gestion de la société. Les créanciers disposent d’autres moyens pour protéger leurs intérêts. Ils peuvent par exemple exercer une action paulienne ou prendre une mesure conservatoire pour bloquer un élément d’actif de la société débitrice le temps de la procédure mais les créanciers ne peuvent pas faire désigner un administrateur provisoire. Par Olivier Vibert, avocat au barreau de Paris,
Validation judiciaire de la clause attributive de compétence dans les conditions générales d’utilisation ou CGU de Meta
Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-12.384 Dans un arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation confirme l’efficacité d’une clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales d’utilisation (CGU) d’un compte Instagram professionnel. La Cour de cassation écarte l’article 1171 du code civil, disposition protectrice française protégeant la partie faible contre une clause générant un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion. Un litige post-piratage contre Meta Mme [W], créatrice de contenu, avait ouvert un compte Instagram professionnel en 2010. Ce compte, géré par sa société VRT, avait fait l’objet d’un piratage, ce qui avait conduit les demanderesses à assigner la société Meta Platforms Ireland devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant réparation. Meta a opposé une clause attributive de compétence, insérée dans ses CGU, désignant les tribunaux irlandais comme seuls compétents. L’article 1171 du Code civil, une loi de police ? Mme [W] invoquait l’article 1171 du Code civil, qui sanctionne dans les contrats d’adhésion toute clause créant un déséquilibre significatif entre les parties. Elle soutenait que cette disposition constituait une loi de police, s’imposant même en présence d’une clause attributive de juridiction. La cour d’appel n’a pas retenu cet argument, et la Cour de cassation confirme. La cour de cassation rappelle en effet que les conventions d’élection de for sont expressément exclues du champ d’application du règlement Rome I sur la Loi applicable n°593/2008. Le règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, qui régit la compétence judiciaire dans l’Union européenne, ne prévoit aucune réserve particulière au bénéfice des lois de police. Pour la Cour de cassation, la clause de compétence s’impose donc au juge français qui se doit déclarer incompétent. Il incombe au juge irlandais de statuer sur sa validité ou non. Une lecture rigoureuse mais conforme du droit européen L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante, bien que parfois critiquée : les clauses attributives de compétence prévues dans les CGU des grandes plateformes sont pleinement opposables aux professionnels, même en cas de déséquilibre contractuel. La Cour rappelle qu’un éventuel contrôle de validité de la clause ne peut se faire qu’au regard du droit de l’État membre désigné – ici, l’Irlande – sans que la France puisse invoquer ses règles de protection du contractant faible. Cet arrêt conforte les entreprises dans leur stratégie de centralisation juridictionnelle et souligne les limites de l’article 1171 du Code civil en présence d’un contrat international qui n’a pas vocation à s’appliquer pour les clauses de compétence juridictionnelle. Par Olivier Vibert, Avocat au barreau de Paris
Droit du conjoint et société : la renonciation tacite à la qualité d’associé doit être non équivoque
Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372 Par un arrêt rendu le 12 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme qu’en régime de communauté légale, le conjoint d’un époux ayant effectué un apport à une société avec des biens communs peut revendiquer la qualité d’associé sauf renonciation tacite non équivoque. L’arrêt illustre les exigences posées par l’article 1832-2 du Code civil. Les faits : un époux revendique sa qualité d’associé près de 15 ans après la notification M. et Mme [N] s’étaient mariés sans contrat en 1970, sous le régime de la communauté légale. En 2007, M. [N] notifiait à la société Transports [N], dirigée par son épouse, son intention de se prévaloir de l’article 1832-2 du Code civil, afin de revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts sociales apportées par Mme [B] au moyen de biens communs. Face au refus de sa conjointe de lui communiquer les documents sociaux, M. [N] a engagé une action judiciaire pour obtenir la reconnaissance de sa qualité d’associé. La société Transports [N] et Mme [B] faisaient valoir que M. [N] avait tacitement renoncé à ce droit, notamment parce que chacun avait constitué sa propre société sans participation croisée, traduisant une volonté d’indépendance juridique et patrimoniale. ⚖️ Le cadre juridique : l’article 1832-2 du Code civil L’article 1832-2 du Code civil reconnaît un droit au conjoint non associé d’une société à se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts acquises ou souscrites par son époux(se) commun en biens, sauf stipulation contraire ou renonciation. La jurisprudence constante reconnaît que cette renonciation peut être expresse ou tacite, mais doit résulter d’un comportement sans équivoque, incompatible avec l’exercice du droit d’association. 🧾 La décision : pas de renonciation établie en l’espèce La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, avait accueilli la demande de M. [N] et reconnu sa qualité d’associé depuis 2007. La Cour de cassation valide cette décision. La Cour de cassation rappelle en premier lieu que : « (…) si le conjoint de l’époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit. Cette renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé. » Pour la Cour de cassation, si la constitution concomitante de sociétés séparées peut témoigner d’une volonté de gestion autonome, elle ne suffit pas à établir une renonciation claire et non équivoque. En l’absence d’éléments démontrant un comportement manifestement incompatible avec la volonté d’être associé le droit de revendication subsiste. La renonciation peut par exemple résulter d’un accord familial ou d’un accord statutaire d’exclusion. Une appréciation stricte de la renonciation La Cour rappelle que le silence, l’inaction ou la distance entre les époux dans la gestion de leurs sociétés respectives ne suffisent pas à établir une renonciation tacite. Il faut démontrer un comportement incompatible, constant et non équivoque avec la volonté d’être reconnu comme associé. 📌 À retenir Attention : Si vous constituez une société soyez vigilant et anticipez cette question en prévoyant ou non la renonciation du conjoint à être associé. Il est important de déterminer si le conjoint renonce à sa qualité d’associé avant afin d’éviter ensuite un débat sur la détention des parts sociales. Les enjeux financiers plusieurs années après la création de la société peuvent être évidemment très importants. Ce type de litige peut aussi conduire à un blocage de la société. Article rédigé par Olivier Vibert
Concurrence déloyale dans la joaillerie de luxe : Absence de parasitisme par Louis Vuitton
Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157 Les faits Les sociétés Richemont et Cartier ont intenté une action contre Louis Vuitton, affirmant que la collection « Color Blossom » reprenait les codes stylistiques de la gamme de bijoux « Alhambra » (trèfle quadrilobé en pierre précieuse cerclé de métal). Ce litige entre deux acteurs majeurs du luxe portait sur la notion de parasitisme. Richemont et Cartier estimaient que cette similitude traduisait une stratégie de captation de la notoriété et du savoir-faire des collections « Alhambra », commercialisées depuis 1968. Le cadre juridique du parasitisme économique Le parasitisme est une forme de concurrence déloyale. Il est défini comme une stratégie consistant à se placer dans le sillage d’un concurrent pour bénéficier indûment de sa notoriété, de ses investissements ou de son savoir-faire. La Cour de cassation dans son arrêt apporte une définition du parasitisme conforme à sa jurisprudence antérieure : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion. » Pour être caractérisé, le parasitisme doit réunir plusieurs éléments : La Cour de cassation fidèle à sa démarche pédagogique précise également les éléments à caractériser pour justifier d’un parasitisme : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. » Décision de la Cour de cassation La Cour rejette le pourvoi et exclut le parasitisme. La Cour de cassation reconnaît que le modèle « Alhambra » est un produit emblématique et notoire de la marque qui représente une valeur économique individualisée. En effet, pour la Cour de cassation, il n’y a pas eu d’intention de LOUIS VUITTON de se placer dans le sillage de CARTIER. « les sociétés Vuitton se sont inspirées de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée, et non du modèle « Alhambra », et que c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société [L] & [M] ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection « Color Blossom », des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux, la cour d’appel, qui, après avoir examiné séparément chacun des éléments invoqués par les sociétés du groupe Richemont, les a appréhendés dans leur globalité et qui n’a pas méconnu les ressemblances entre les deux collections, a pu, sans avoir à procéder aux recherches visées aux quatrième et cinquième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la sixième branche, déduire que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont. » Cette décision confirme une jurisprudence bien établie selon laquelle l’inspiration issue d’une tendance générale du marché ne constitue pas en soi un acte de parasitisme. Conséquences et portée L’arrêt rappelle qu’en matière de concurrence dans l’industrie du luxe, l’originalité d’un design ne suffit pas à fonder une action en parasitisme. Il faut prouver une captation déloyale du travail d’un concurrent. Cette affaire illustre la difficulté pour les grandes maisons d’obtenir une protection absolue sur des motifs de design récurrents dans la joaillerie. Cette décision démontre également que l’inspiration ne constitue pas nécessairement un parasitisme et la difficulté à justifier du parasitisme. Par Olivier VIBERT Avocat, Paris Kbestan, www.kbestan.fr
Monopole bancaire et secret des affaires : litige entre franchises de pizzas à emporter
Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-10.953 Dans cette affaire opposant deux réseaux de restaurants de pizzas à emporter, deux thématiques centrales du droit des affaires se croisent : les limites du monopole bancaire dans les relations franchiseur-franchisé et le difficile équilibre entre secret des affaires et droit à la preuve. Si l’octroi de financements aux franchisés peut être un levier économique stratégique, il doit respecter le monopole bancaire. Par ailleurs, l’utilisation de documents confidentiels en justice pose la question des limites du secret des affaires, qui ne saurait faire obstacle au droit à la preuve. Les faits La société ABC Food, franchisée de Speed Rabbit Pizza, reprochait à Domino’s Pizza France et à son franchisé French Pizza de fausser la concurrence en leur accordant des prêts dissimulés sous forme d’apports en compte courant et des délais de paiement excessifs, pratiques interdites par le monopole bancaire. Estimant que ces avantages constituaient une pratique anticoncurrentielle, ABC Food et Speed Rabbit Pizza ont assigné Domino’s Pizza et French Pizza en cessation de ces pratiques et en paiement de dommages et intérêts. De son côté, Domino’s Pizza a demandé des dommages et intérêts en invoquant la violation du secret des affaires, arguant que ses adversaires avaient produit en justice un document interne confidentiel contenant des informations stratégiques sur son réseau de franchise. Les décisions de justice La cour d’appel de Paris avait donné raison à Domino’s Pizza, en validant l’opération de financement et en condamnant ABC Food et Speed Rabbit Pizza à 30 000 euros de dommages et intérêts pour avoir utilisé un document couvert par le secret des affaires. La Cour de cassation casse partiellement cette décision et rappelle deux principes essentiels : 1 – Monopole bancaire et réseau de distribution Le monopole bancaire interdit aux entreprises d’octroyer des crédits à titre habituel, sauf exceptions strictement encadrées (art. L. 511-5 et L. 511-7 du Code monétaire et financier). Cette interdiction existe également dans le cadre d’un réseau commercial comme la franchise notamment. Un franchiseur ne peut pas financer l’activité du franchisé en principe car ceci constituerait une activité bancaire réservée aux établissements de crédit. Cette règle a imposé à certains sociétés à la tête d’un réseau de points de vente de disposer d’une filiale bancaire pour accorder des financements aux points de vente. Une dérogation cependant au monopole bancaire existe quand une société mère finance l’activité d’une filiale ou plus largement d’une société qu’elle contrôle. Le financement par apport en compte courant ne relève pas alors du monopole bancaire. La Cour de cassation rappelle dans cette décision que l’exception permettant à une entreprise de prêter à une société qu’elle contrôle par un apport en compte courant ne s’applique que si ce contrôle existe déjà au moment du prêt. La Cour de cassation approuve ainsi la décision de la Cour d’appel qui n’avait pas retenu une infraction au monopole bancaire. La société à la tête du réseau de distribution n’était certes pas encore actionnaire du point de vente mais « par l’effet de la promesse synallagmatique de cession et d’achat de la totalité des parts sociales de la société French Pizza, la société Domino’s Pizza la contrôlait effectivement à la date de l’avance en compte courant » Le contrôle effectif de la société a donc pu intervenir dès la signature de la promesse de cession et sans attendre la cession des actions ou des parts sociales. 2️ – Secret des affaires et droit à la preuve : un équilibre à trouver L’autre volet de cette décision concernait le secret des affaires. Domino’s Pizza accusait ses adversaires d’avoir produit un document confidentiel interne dans le cadre du procès, demandant une réparation de 30 000 euros. La Cour d’appel avait validé cette demande et condamné SPEED RABBIT PIZZA. La Cour de cassation casse cette condamnation et rappelle que le secret des affaires n’est pas absolu (art. L. 151-8 du Code de commerce). En effet la Cour de cassation rappelle en premier lieu les règles en jeu à savoir les articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. « A l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. » « Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. » La Cour de cassation reproche ensuite à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si la production d’une pièce protégée par le secret des affaires n’était pas indispensable à prouver les faits allégués. « Pour condamner les sociétés SRP et ABC Food à des dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l’instance, une pièce protégée par le secret des affaires, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré que la production de cette pièce constituerait une exception à la protection du secret des affaires prévues aux articles L. 151-7 et L. 151-8 du code de commerce, notamment qu’elle serait justifiée par la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La Cour de cassation rappelle donc qu’un document confidentiel couvert par le secret des affaires peut être produit en justice si son utilisation est indispensable et proportionnée au but poursuivi. Le secret des affaires : une protection relative Le secret des affaires est une protection essentielle pour les entreprises mais qui