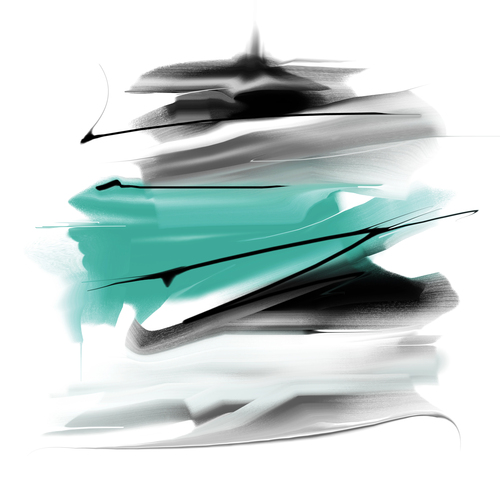Cass. civ. 2ème, 12 juin 2025, n°22-24.111 La Cour de cassation précise les modalités d’application de la présomption légale relative au siège social des sociétés, en soulignant que celui-ci reste réputé être celui inscrit au registre du commerce tant qu’aucun changement n’est opéré légalement, sauf preuve explicite de fraude ou fictivité. La société SCI BD avait formé une déclaration de saisine devant la cour d’appel de Paris, en indiquant une adresse de siège social contestée par la société Etude JP et la société Pool, sur la base d’une impossibilité pour un huissier de signifier des actes à cette adresse. La cour d’appel avait prononcé la nullité de la déclaration de saisine en considérant erronée l’adresse indiquée par la SCI BD. La Cour de cassation censure cette décision et rappelle la règle essentielle selon laquelle : « Une société, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux. » Elle précise ainsi qu’en l’absence de preuve explicite démontrant que le siège social est fictif ou frauduleux, la simple difficulté pratique rencontrée lors d’une signification ne suffit pas à remettre en cause la validité juridique du siège social régulièrement inscrit. Cet arrêt confirme donc l’importance de l’inscription officielle du siège social. La mention du siège social dans un acte est valable sauf si ce siège est fictif ou frauduleux. Ce n’est pas parce que l’huissier Cette solution est la bienvenue pour les praticiens. Il arrive souvent qu’un huissier ait du mal à délivrer un acte alors même que la société est bien domiciliée à cette adresse notamment lorsqu’aucune boite aux lettres n’existe au nom de la société. La solution inverse aurait conduit à de multiples discussions lorsque l’huissier rencontre des difficultés à signifier un acte. Cette solution de la Cour de cassation présente donc l’avantage de limiter les débats autour de l’adresse de la société et de renforcer le siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés. Par Olivier VIBERT KBESTAN, cabinet de droit des affaires à Evreux et Paris. www.kbestan.fr
Fixation judiciaire du prix de cession d’un fonds de commerce : un rappel clair des limites du pouvoir du juge
Cass. com., 4 juin 2025, n°24-11.580 Dans cet arrêt, la Cour de cassation souligne clairement que le juge ne peut substituer son appréciation à celle des parties pour fixer le prix d’une vente. Cette décision réaffirme l’interdiction formelle pour le juge de procéder à une fixation judiciaire du prix et délimite les pouvoirs des juges. La société Pharmacie Girardeaux avait conclu une promesse de cession d’un fonds de commerce de pharmacie à la société Pharmacie Bourdois, prévoyant une détermination du prix définitif par référence à un chiffre d’affaires annuel retraité de divers éléments. Faute d’accord définitif entre les parties sur les éléments à déduire, un tiers évaluateur devait être désigné pour fixer définitivement le prix. La cour d’appel de Poitiers avait néanmoins décidé elle-même de fixer le prix de cession, en estimant le montant des éléments contestés et en procédant ainsi à une évaluation judiciaire directe. La Cour de cassation censure vigoureusement cette décision en rappelant le principe posé par les articles 1591 et 1592 du Code civil selon lequel « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » ou à défaut, être fixé « par un tiers » mais en aucun cas par le juge : « En approuvant le tribunal d’avoir chiffré lui-même, pour déterminer le prix de cession, le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient en désaccord, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Cette décision rappelle clairement que les juges ne peuvent intervenir que dans les limites strictes définies par les parties et par la loi, et ne peuvent en aucun cas substituer leur propre appréciation à celle d’un tiers évaluateur désigné ou à désigner selon le processus qui avait été défini dans le contrat. Cette décision conforte ainsi la sécurité juridique des contrats et la volonté des parties, le juge ne pouvant pas prendre l’initiative de se substituer à ce tiers. L’intention était certainement louable mais le juge doit se limiter à ce que les parties ont défini. Par Olivier Vibert, Avocat au barreau de Paris et associé au sein du cabinet de droit des affaires KBESTAN.
Expertise en évaluation de parts sociales : l’expert détient seul le pouvoir de fixer la valeur des parts sociales
Cour de cassation, Chambre Commerciale arrêt du 7 mai 2025, pourvoi n°23-24.041 Dans cet arrêt du 7 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les limites du contrôle que peut exercer un juge sur la mission d’un expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil pour l’évaluation des parts sociales. Plusieurs sociétés actionnaires avaient été exclues de la société Pharmabest. Un expert avait été désigné judiciairement afin de déterminer la valeur des actions détenues par les sociétés exclues, en application des statuts ou conventions existantes. L’article 1843-4 du code civil dispose que : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. » L’évaluation de la valeur des parts sociales est souvent un sujet délicat et source de litiges, les critères d’évaluation retenus par un expert étant rarement acceptés par tous les associés. Dans cette affaire, face au désaccord des parties sur l’exercice comptable à prendre en compte pour fixer cette valeur, l’expert avait proposé deux évaluations différentes. L’expert a laissé ensuite au juge le soin de sélectionner l’évaluation à retenir selon l’interprétation de la volonté des associés. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a cependant annulé certaines clauses de la lettre de mission, estimant que l’expert ne pouvait proposer plusieurs évaluations et devait suspendre sa mission en invitant les parties à saisir le juge afin que celui-ci tranche préalablement le litige sur l’interprétation des conventions. La Cour de cassation casse partiellement cette décision, rappelant fermement que l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil détient seul le pouvoir de fixer la valeur des parts sociales. L’expert peut valablement retenir plusieurs évaluations correspondant aux interprétations différentes revendiquées par les parties, laissant alors au juge le soin d’identifier la commune intention des parties pour choisir l’évaluation appropriée. En obligeant l’expert à interrompre ses travaux et à solliciter une intervention judiciaire préalable sur l’interprétation contractuelle, la Cour d’appel avait excédé ses pouvoirs et violé l’article 1843-4, I, du Code civil. La Cour de cassation réaffirme ainsi clairement l’autonomie et l’étendue des pouvoirs de l’expert en matière d’évaluation des parts sociales. Elle valide ainsi la démarche de l’expert qui en présence de deux interprétations possibles avait préféré ne pas arbitrer entre ces interprétations et laisser au juge le soin de faire cet arbitrage. Cette volonté de l’expert était louable et respectueuse de la limite de ses pouvoirs, laissant au juge ensuite la liberté de choisir le mode d’évaluation à retenir. Cette solution était surtout plus efficace, permettant à l’expert de clore sa mission puis de laisser les juges arbitrer. La solution de la Cour d’appel d’Aix était plus complexe et contraignante. Elle imposait les parties à une double procédure. Cette solution de la Cour de cassation semble donc pragmatique et limite le risque d’une complexité procédurale inutile. Par Olivier Vibert, Avocat au Barreau de Paris
Concurrence déloyale dans la joaillerie de luxe : Absence de parasitisme par Louis Vuitton
Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157 Les faits Les sociétés Richemont et Cartier ont intenté une action contre Louis Vuitton, affirmant que la collection « Color Blossom » reprenait les codes stylistiques de la gamme de bijoux « Alhambra » (trèfle quadrilobé en pierre précieuse cerclé de métal). Ce litige entre deux acteurs majeurs du luxe portait sur la notion de parasitisme. Richemont et Cartier estimaient que cette similitude traduisait une stratégie de captation de la notoriété et du savoir-faire des collections « Alhambra », commercialisées depuis 1968. Le cadre juridique du parasitisme économique Le parasitisme est une forme de concurrence déloyale. Il est défini comme une stratégie consistant à se placer dans le sillage d’un concurrent pour bénéficier indûment de sa notoriété, de ses investissements ou de son savoir-faire. La Cour de cassation dans son arrêt apporte une définition du parasitisme conforme à sa jurisprudence antérieure : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion. » Pour être caractérisé, le parasitisme doit réunir plusieurs éléments : La Cour de cassation fidèle à sa démarche pédagogique précise également les éléments à caractériser pour justifier d’un parasitisme : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. » Décision de la Cour de cassation La Cour rejette le pourvoi et exclut le parasitisme. La Cour de cassation reconnaît que le modèle « Alhambra » est un produit emblématique et notoire de la marque qui représente une valeur économique individualisée. En effet, pour la Cour de cassation, il n’y a pas eu d’intention de LOUIS VUITTON de se placer dans le sillage de CARTIER. « les sociétés Vuitton se sont inspirées de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée, et non du modèle « Alhambra », et que c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société [L] & [M] ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection « Color Blossom », des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux, la cour d’appel, qui, après avoir examiné séparément chacun des éléments invoqués par les sociétés du groupe Richemont, les a appréhendés dans leur globalité et qui n’a pas méconnu les ressemblances entre les deux collections, a pu, sans avoir à procéder aux recherches visées aux quatrième et cinquième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la sixième branche, déduire que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont. » Cette décision confirme une jurisprudence bien établie selon laquelle l’inspiration issue d’une tendance générale du marché ne constitue pas en soi un acte de parasitisme. Conséquences et portée L’arrêt rappelle qu’en matière de concurrence dans l’industrie du luxe, l’originalité d’un design ne suffit pas à fonder une action en parasitisme. Il faut prouver une captation déloyale du travail d’un concurrent. Cette affaire illustre la difficulté pour les grandes maisons d’obtenir une protection absolue sur des motifs de design récurrents dans la joaillerie. Cette décision démontre également que l’inspiration ne constitue pas nécessairement un parasitisme et la difficulté à justifier du parasitisme. Par Olivier VIBERT Avocat, Paris Kbestan, www.kbestan.fr