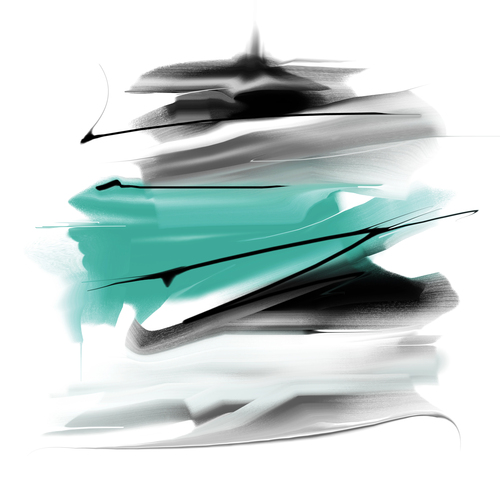Cass. com., 4 juin 2025, n°24-11.580 Dans cet arrêt, la Cour de cassation souligne clairement que le juge ne peut substituer son appréciation à celle des parties pour fixer le prix d’une vente. Cette décision réaffirme l’interdiction formelle pour le juge de procéder à une fixation judiciaire du prix et délimite les pouvoirs des juges. La société Pharmacie Girardeaux avait conclu une promesse de cession d’un fonds de commerce de pharmacie à la société Pharmacie Bourdois, prévoyant une détermination du prix définitif par référence à un chiffre d’affaires annuel retraité de divers éléments. Faute d’accord définitif entre les parties sur les éléments à déduire, un tiers évaluateur devait être désigné pour fixer définitivement le prix. La cour d’appel de Poitiers avait néanmoins décidé elle-même de fixer le prix de cession, en estimant le montant des éléments contestés et en procédant ainsi à une évaluation judiciaire directe. La Cour de cassation censure vigoureusement cette décision en rappelant le principe posé par les articles 1591 et 1592 du Code civil selon lequel « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » ou à défaut, être fixé « par un tiers » mais en aucun cas par le juge : « En approuvant le tribunal d’avoir chiffré lui-même, pour déterminer le prix de cession, le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient en désaccord, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Cette décision rappelle clairement que les juges ne peuvent intervenir que dans les limites strictes définies par les parties et par la loi, et ne peuvent en aucun cas substituer leur propre appréciation à celle d’un tiers évaluateur désigné ou à désigner selon le processus qui avait été défini dans le contrat. Cette décision conforte ainsi la sécurité juridique des contrats et la volonté des parties, le juge ne pouvant pas prendre l’initiative de se substituer à ce tiers. L’intention était certainement louable mais le juge doit se limiter à ce que les parties ont défini. Par Olivier Vibert, Avocat au barreau de Paris et associé au sein du cabinet de droit des affaires KBESTAN.
Communication de pièces en langues étrangères devant le juge français
Le 27 novembre 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt confirmant la validité de l’utilisation de documents en langue étrangère comme éléments de preuve dans un litige, même en l’absence de traduction officielle. Cet arrêt met en évidence la souplesse de textes anciens pour être adaptés aux pratiques internationales. (Chambre commerciale, arrêt du 27/11/2024, pourvoi n° 23-10.433) Les Faits et l’Enjeu Linguistique Dans cette affaire, M. et Mme [N], anciens associés de la société Pole Position Assurances, contestaient la validité de la cession de leurs actions, qu’ils prétendaient avoir réalisée sous l’effet d’un dol. Parmi les éléments clés du litige figuraient des courriels en anglais échangés entre les parties et des tiers, notamment une compagnie d’assurance britannique. M. et Mme [N] arguaient que ces documents, rédigés en langue étrangère et non traduits en français, ne pouvaient être valablement retenus comme preuves. Ils invoquaient notamment l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui impose l’usage exclusif de la langue française dans les actes judiciaires, ainsi que le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de Villers-Cotterêts) Ce texte de François Ier était destiné à rendre des décisions mieux comprises. A ces fins, cette Ordonnance prévoyait l’utilisation du français dans les procédures judiciaires françaises au lieu du latin. Ce texte toujours en vigueur ne manque pas de nous renvoyer vers une forme plus ancienne de la langue française. Version Légifrance de ce texte : François, par la grâce de Dieu, roy de France, sçavoir,faisons, à tous présens et advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, abréviation des proçès, et soulagement de nos sujets avons, par édit perpétuel et irrévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons les choses qui s’ensuivent. Article 110 Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ne lieu à demander interprétation. Article 111 Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement. La Position de la Cour de Cassation, La Cour de cassation a rejeté cet argument et validé l’usage des courriels en anglais, en précisant que : La Cour a également estimé que l’absence de traduction n’avait pas porté atteinte au droit à un procès équitable, les parties ayant eu la possibilité de présenter leurs arguments et de contester ces pièces. Une Jurisprudence en Évolution Cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle reconnaissant l’importance des réalités économiques et commerciales internationales. En effet, dans un contexte globalisé, l’échange de documents en langue étrangère est fréquent, notamment dans des affaires impliquant des parties internationales. La Cour de cassation avait déjà abordé cette question dans des arrêts antérieurs, en soulignant que le juge pouvait librement apprécier la nécessité d’une traduction. Cette flexibilité vise à éviter un formalisme excessif qui ralentirait les procédures sans garantir une meilleure administration de la justice. Une solution pragmatique La décision du 27 novembre 2024 reflète un pragmatisme juridique. Elle repose sur plusieurs considérations : Les Limites et Précautions à Prendre Malgré cette ouverture, certaines précautions doivent être observées : Implications pratiques pour les acteurs économiques Cet arrêt a des implications significatives pour les entreprises et leurs conseils : En validant l’usage de documents en langue étrangère dans des litiges nationaux, l’arrêt du 27 novembre 2024 concilie respect des règles procédurales françaises et pragmatisme au développement des échanges commerciaux internationaux. Cette décision démontre enfin qu’avec un texte ancien, destiné à l’époque à faire cesser l’usage judiciaire du latin, il est possible de faire évoluer les pratiques pour les adapter aux évolutions économiques sans forcément passer par une nouvelle réforme ou un nouveau texte. Si l’usage du français demeure la règle, l’Ordonnance autorise une souplesse bienvenue dans les litiges internationaux si les principes du droit à un procès équitable sont respectés. Par Olivier Vibert, avocat, Paris